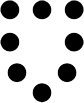Sheelasha Rajbhandari & Hit Man Gurung
De la terre à l’esprit : petits rituels de rassemblement.
Alors que les systèmes de mouvement fluides autrefois liés aux écosystèmes et aux cycles saisonniers se rigidifient, comment les migrations – internes, transrégionales et internationales – ont-elles modifié la vie de celleux qui sont enracinés dans la terre, les forêts et les rivières ? Comment les personnes issues des traditions agricoles et pastorales gèrent-elles les connaissances fragmentées du sol, des plantes, des animaux et des esprits ?
Comment l’homogénéisation du terme « queer » a-t-elle eu un impact sur les structures de parenté, ainsi que sur les expressions non binaires et fluides du genre et de la sexualité dans les cultures indigènes et vernaculaires ? Comment portons-nous des souvenirs ancestraux fragmentés et des histoires de guérison incomplètes tout en naviguant dans l’identité, l’appartenance, l’anxiété, l’infériorité et le syndrome de l’imposteur ?
Dans un monde patriarcal, binaire et capitaliste, le contrôle de la terre et des corps a longtemps renforcé le pouvoir. Pouvons-nous nous réunir pour partager des repas, nous rassembler autour d’un feu et engager des conversations constructives pour imaginer un monde qui remette en question les récits dominants ? Un monde qui embrasse diverses façons d’être, d’aimer et d’entretenir des relations, au-delà de l’effacement et du rejet ?
Tout en honorant les individus et les mouvements passés et présents, pouvons-nous partager les histoires transmises par les aînés et les parents retrouvés ? Pouvons-nous reconnaître le pouvoir des petits rituels de rassemblement, des amitiés, des moments de repos qui extériorisent nos luttes internes ?
Sheelasha Rajbhandari est une artiste et une commissaire d’exposition basée à Katmandou. Ses œuvres s’appuient sur une lignée de féminités incarnées et spéculatives pour remettre en question le positionnement des femmes et des êtres fluides à travers le temps, les paysages et les cosmologies. Sa pratique est une provocation à réfléchir au-delà de la conception néolibérale du temps afin de décentrer les structures patriarcales qui perpétuent les cycles d’extraction industrielle et d’épuisement individuel. Pour elle, faire de l’art, c’est créer un espace pour l’action collective. Ce questionnement alimente sa récente approche artistique et curatoriale qui recompose les notions d’indigénéité, de genre, de sexualité, de valeur et de productivité.
Rajbhandari est co-commissaire pour le projet Tamba à la 11e Triennale Asie-Pacifique 2024. Elle est l’une des conservatrices de la 17e Biennale Jogja 2023 et du Colomboscope 2024. Elle est co-commissaire de la Triennale de Katmandou 2077, du pavillon du Népal à la Biennale de Venise (2022), de « Garden of Ten Seasons “ à Savvy Contemporary, Berlin (2022) et de ” 12 Baishakh, » Bhaktapur (2015) aux côtés de Hit Man Gurung. Son installation textile a été exposée au Kunstinstituut Melly (2023), au Museum of Art and Design ; NewYork (2022), au Footscray Art Center ; Melbourne ( 2022). Son installation dans l’exposition itinérante « A beast, a god and a line » (2018-2020) a été présentée à Para Site, Hong Kong ; TS1, Yangon ; Museum of Modern Art, Varsovie ; Kunsthall, Trondheim ; et MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai. Elle a également été artiste en résidence aux Bellas Artes Projects (2019) et à Para Site (2017). Dans le cadre de son collectif, elle a fait partie du Dhaka Art Summit (2020) et de la Biennale de Sydney (2020). Rajbhandari a élaboré l’initiative Dankini, qui donne la priorité au repos et au plaisir sensoriel tout en approfondissant la complexité de l’identité et des forces structurelles. Elle est également cofondatrice d’ArtTree Nepal, un collectif d’artistes, et de Kalā Kulo, une initiative artistique.
Hit Man Gurung est un artiste et un conservateur basé à Katmandou en passant par Lamjung. La pratique diversifiée de Gurung s’intéresse au tissu des mobilités humaines, aux frictions de l’histoire et aux échecs des révolutions. Bien qu’enracinées dans l’histoire récente du Népal, ses œuvres démêlent un réseau complexe de liens de parenté et d’extraction à travers les géographies qui soulignent la nature exploiteuse du capitalisme. Ces récits tournent autour des expériences vécues par les migrants pris entre une industrie transnationale déshumanisante basée sur le travail et un État-nation apathique. Il invoque en outre les méthodologies et épistémologies indigènes pour reconfigurer fondamentalement la praxis artistique contemporaine.
Gurung est co-commissaire du projet Tamba à la 11e Triennale Asie-Pacifique 2024. Il est l’un des commissaires de la 17e Biennale Jogja 2023 et du Colomboscope 2024. Il est co-commissaire de la Triennale de Katmandou 2077 (2022), du Pavillon du Népal à la Biennale de Venise (2022), de « Garden of Ten Seasons “ à Savvy Contemporary, Berlin (2022) et de ” 12 Baishakh, » Bhaktapur (2015) aux côtés de Sheelasha Rajbhandari. Il a également cofondé ArtTree Nepal, un collectif d’artistes, et Kalā Kulo, une initiative artistique. Il a participé à des expositions à SAVVY Contemporary, Berlin (2020) ; à la Biennale de Sydney (2020) ; à Artspace Sydney (2019) ; à Weltmuseum Wien (2019) ; à la Triennale de Katmandou (2017) ; à la Biennale de Yinchuan (2016) ; à Para Site, Hong Kong (2016) ; à la Triennale d’art contemporain de l’Asie-Pacifique, Brisbane (2015-16) ; et à Dhaka Art Summit (2014, 2016, 2018, 2020).
Un partenariat avec Pro Helvetia & One Gee in Fog.

Année de résidence